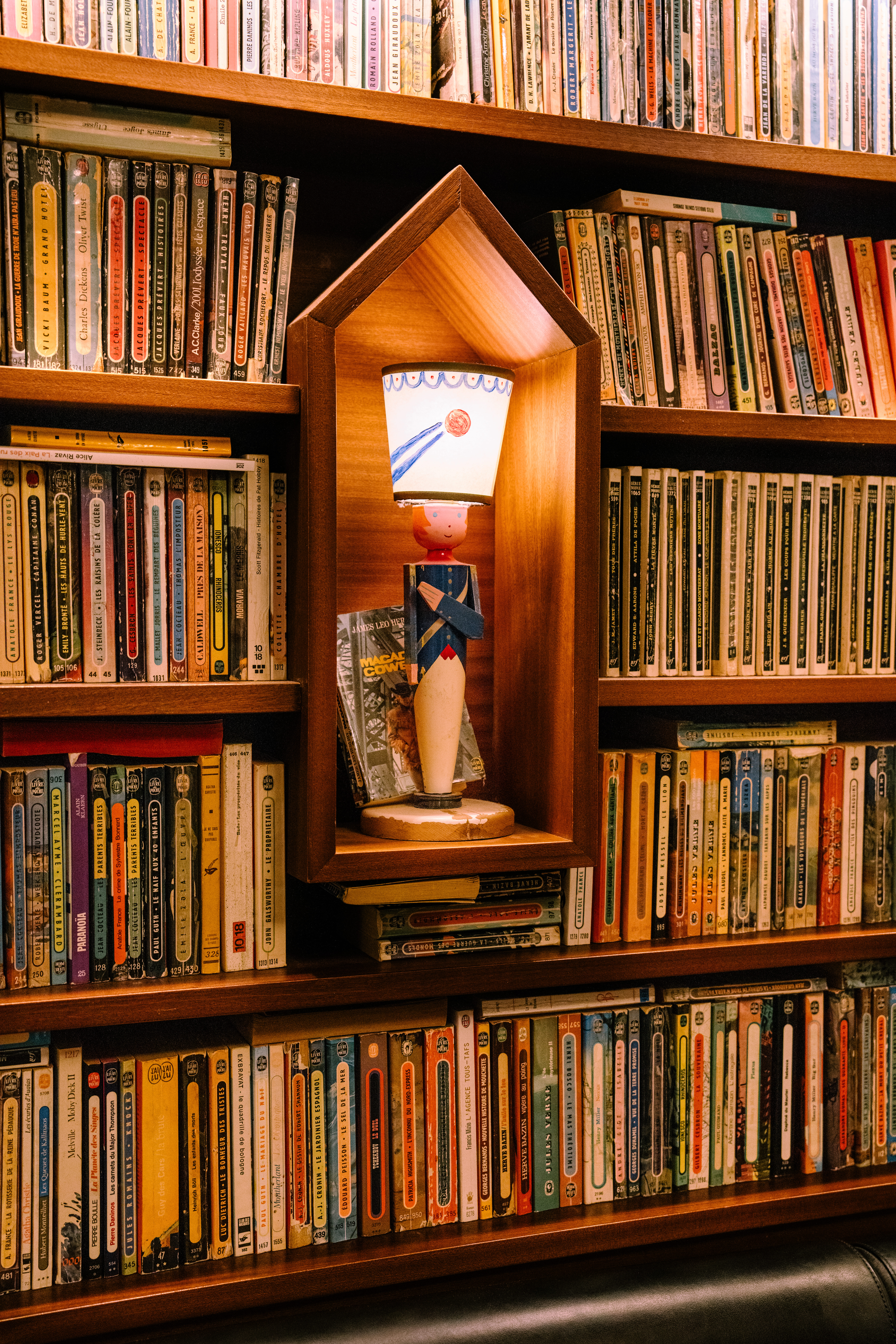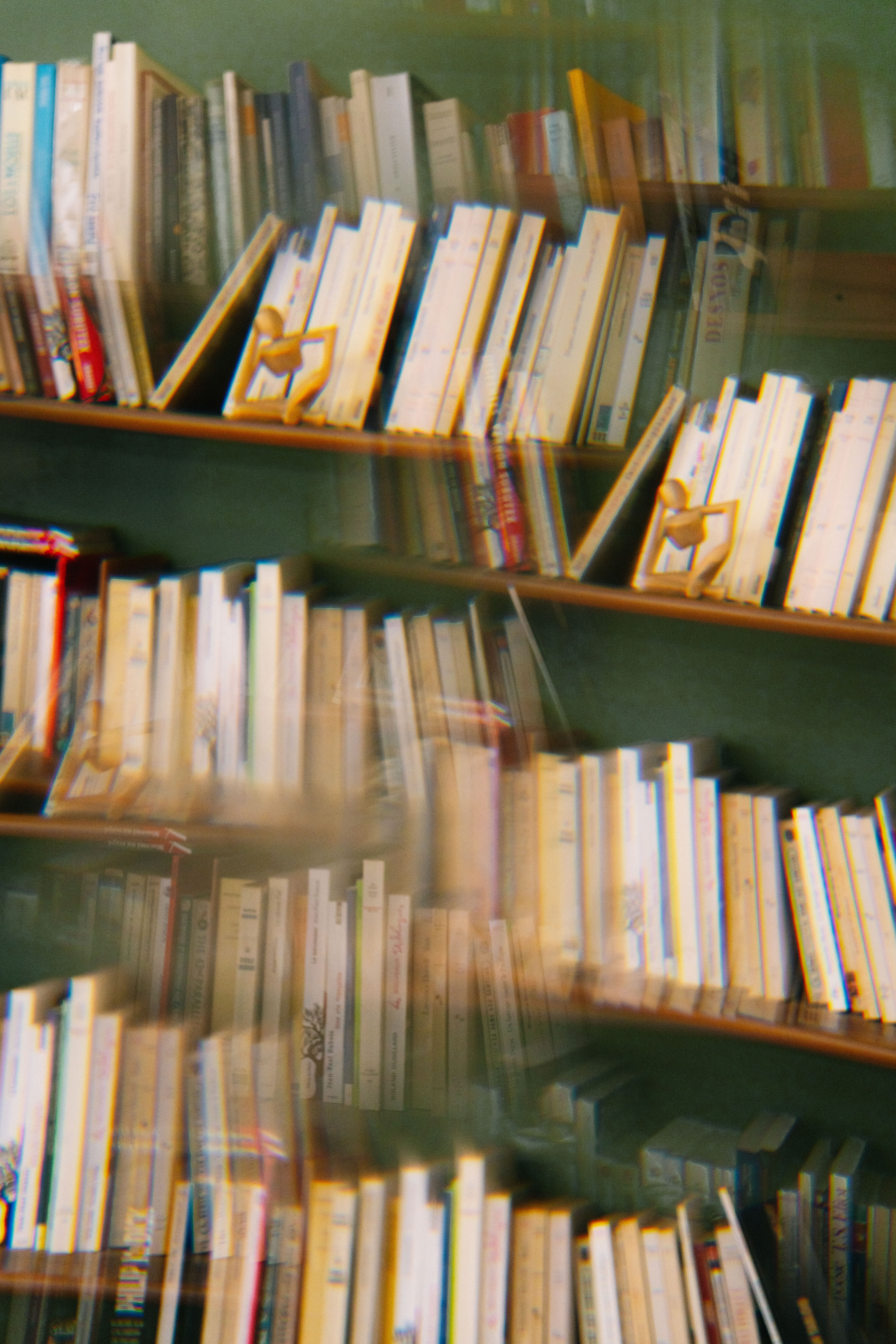L'invitée — Asma Mhalla
Publié le 05 mars 2025
écrit par
Chloé Elbaz et photographié par Sarah Witt
Postulant que la technologie est politique, Asma Mhalla a fait d’un mot son arme : la technopolitique. Docteure en sciences politiques et chercheuse au Laboratoire d’Anthropologie Politique de l’EHESS, elle a publié l’année dernière Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats, aux éditions du Seuil. Un premier ouvrage très remarqué tant il fait écho à l’actualité d’aujourd’hui et s’attaque aux défis de demain : l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le métavers ou encore les implants cérébraux. Asma Mhalla décrypte ces outils pour mieux interroger notre rapport au pouvoir, à la technologie et à la société. Elle pourrait en parler des heures, FLAASH aussi. Rencontre résumée.
— À Alain Damasio la « technocritique », à vous la « technopolitique ». Comment la définiriez-vous ?
La technopolitique est un constat simple, civique et citoyen, qui précède même le politique : la technologie est politique. Dès lors que l’on en prend conscience, la technopolitique appartient à tout le monde, et chacun doit s’en saisir. Car c’est elle qui va déterminer la manière dont notre civilisation et notre société se déploieront. Les réseaux sociaux, l’IA générative, le métavers ou les implants cérébraux ne sont pas simplement des outils technologiques. Ils représentent de véritables infrastructures qui peuvent parfois même contenir et véhiculer une idéologie. Il nous revient de comprendre ces derniers, et leur place dans notre société, afin de reprendre une forme de contrôle. Si l’on saisit cela, alors on a déjà fait une partie du chemin.
— Sur ce chemin, quelle place pour la France et l'Europe face aux géants américains et chinois de la tech ?
Il y a plusieurs choses à considérer. D’abord, la rivalité géostratégique mondiale entre les États-Unis et la Chine qui se cristallise autour de la question technologique, et notamment l’intelligence artificielle. C’est aujourd’hui le carburant du leadership militaire. Aucune puissance militaire moderne ne peut se passer de la dimension technologique et algorithmique. Ensuite, l’Europe, coincée entre ces deux superpuissances, a pâti pendant 40 ans d’un manque de vision politique et stratégique, donc d’un vrai déficit de stratégie industrielle, donc de souveraineté technologique. Jusqu’à présent, l’Europe a opté pour une souveraineté normative défensive, avec des régulations comme le Digital Services Act. Cependant, depuis l’arrivée de Donald Trump et d’Elon Musk, les règles du jeu ont changé. Leur agenda vise à démanteler la réglementation européenne, et d’une certaine façon, à casser le dernier bastion que l’on avait encore. Nos alliés historiques ne le sont plus, et l’Europe se retrouve dans un rapport de force qui pourrait devenir extrêmement brutal et presque existentiel. Les mois à venir risquent d’être très compliqués sur ce point.
— Elon Musk (X), Mark Zuckerberg (Facebook), Sam Altman (OpenAI),... Ces figures exercent-elles des relations de pouvoir qui en font des « bras armés » d'intérêts plus larges ?
Oui, les géants technologiques américains, aujourd’hui appelés Big Tech, sont quelques acteurs initialement hétérogènes. J’aime utiliser ce terme pour décrire cette unité politique, malgré les aspérités et les différences. Cela illustre mon concept de technopolitique. Ils sont clairement les bras armés technologiques de la puissance américaine, à l’image des contrats fédéraux passés, notamment militaires et spatiaux. Depuis Barack Obama, un complexe technomilitaire s’est installé, amplifié sous Donald Trump. Ces géants, devenus parties prenantes de l’État, mêlent intérêts privés et publics, ce qui génère des conflits d’intérêts majeurs.
— À la sortie de ce numéro, Donald Trump et Elon Musk seront aux commandes depuis quelques semaines. Quel risque cela représente-t-il sur Terre avec Tesla ou dans l'espace avec Starlink ?
J’en reviens à mes outils technologiques (IA, implants, etc.), qui sont des systèmes, des infrastructures d’utilité publique destinés à tous. Le problème, c’est qu’ils sont détenus par une oligarchie privée. Joe Biden parlait dans son discours d’adieu d’une « nouvelle oligarchie » avec un agenda idéologique clair, très compatible avec le national-populisme réactionnaire (MAGA). Quand on prend le cas d’Elon Musk, en abscisses et en ordonnées, on voit très vite qu’il a privatisé l’espace et le temps sans débat démocratique. Cette concentration de pouvoir pose une question démocratique, voire d’État de droit, qui est fondamentale. Et je ne vois pas, hélas, les contre-pouvoirs qui pourraient se dresser dès aujourd’hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crains qu’il n’y en ait pas beaucoup.
— Quant à Mark Zuckerberg, il aura prononcé son fameux discours annonçant la fin du fact-checking et un certain retour aux sources. « Trop de censure », « donner la parole aux gens » : coup de poker, coup de génie, coup de foudre politique ou coup d'État ?
Coup de masculinité toxique. Mark Zuckerberg semble chercher une appartenance, lui qui devait être très isolé. Son changement de look reflète son intégration dans une « bande ». Le problème, c’est que cette bande est complètement folle et dégénérée, avec notamment un Elon Musk qui fait un peu la pluie et le beau temps en ce moment. Sa posture relève d’un opportunisme économique avant d’être idéologique. Ce n’est pas un reniement pour lui, mais un retour aux sources libertariennes de la Silicon Valley des années 1960 : une liberté d’expression maximaliste, une forme de pied de nez aux médias mainstream verticaux. Ce qui est problématique, c’est de mélanger la modération avec la censure. La liberté, dans un État de droit, implique des limites établies démocratiquement, là où lui et ses pairs sont en train de défendre une liberté maximaliste. Sous-entendu, une liberté sans restriction. En philosophie, on appelle ça la « licence ». Or, si on ne fait plus de fact-checking, si on ne met plus aucune limite, on a alors implicitement le droit d’insulter, d’injurier, de diffamer ou de cyberharceler. Et ça, c’est du délit dans un État de droit, en tout cas en Europe.
— Un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg à la sauce tricolore, ça donnerait quoi ?
Il n’y en a pas, ni même de géants technologiques, et nos industriels sont souvent très frileux et manquent de vision. En revanche, Donald Trump pourrait soutenir Pierre-Édouard Stérin01, qui, par ricochet, développerait des choses. Mais aujourd’hui, il n’y a pas d’équivalent, non seulement en France, mais aussi en Europe.
— Au fond, en veut-on réellement un ?
Le problème des géants technologiques revient toujours à leur statut. Il nous faudrait des infrastructures gouvernées dans une vision de bien commun et d’intérêt général, qui soit une contre-proposition. Créer nos propres réseaux sociaux respirables, libres de la contrainte ou de l’arbitraire de ces géants américains extra-communautaires. Ça m’étonne beaucoup que nos industriels ne s’y soient jamais mis politiquement. Une riposte est nécessaire, mais il ne s’agit pas de copier leur modèle, car leurs dérives idéologiques montrent les dangers de ces gens. Le problème n’est pas l’outil, mais sa gouvernance. Donc un équivalent, non. Une alternative, oui.
— Revenons à l'Homme et la machine. Dans votre ouvrage, vous dites : « Si, parce que nous inaugurons définitivement notre entrée dans l'ère de la symbiose, notre futur se dessinait autrement, loin des considérations exclusives et binaires ? » Pensez-vous que cette vision ouvre la voie à une nouvelle façon d‘envisager la technologie, les relations humaines et les enjeux sociétaux ?
Nos démocraties reposent sur des séparations étanches : public/privé, réel/virtuel, civil/militaire. Mais avec les hypertechnologies, la société devient « liquide »02, comme le décrivait Zygmunt Bauman. Ces technologies sont duales : les réseaux sociaux ou l’IA sont à la fois civils et militaires, outils d’influence ou d’information. Si l’Europe ne comprend pas cette symbiose et la nécessité d’associer startups et défense, à l’instar d’Israël, elle perdra. Plus grave encore, la massification des fausses nouvelles et des deepfakes détruit notre rapport à la réalité, clé de la cohésion sociale. Va-t-on passer à côté d’une énorme bataille ? Je le crains.
En tant que femme politologue, avez-vous fait face à des invectives dans un milieu académique souvent perçu comme fermé ?
C’est l’enfer. La science politique est passionnante car elle permet un spectre d’analyse très large. Elle intègre la data science, le droit, la sociologie... et offre une vision globale. Mais, lorsque l’on embrasse ce système, on fait face à des micro-experts qui se sentent attaqués. En France, le milieu académique est tellement exsangue qu’il ne lui reste plus qu’une forme de reconnaissance symbolique, notamment la visibilité médiatique... Dès lors que vous avez quelqu’un qui pose un système et qui a la chance de pouvoir en parler, vous faites face à un petit milieu d’universitaires. Dans mon cas, ça a été extrêmement violent, agressif et même adversarial. Ce n’est pas exclusif aux femmes et je n’ai encore jamais vu d’exemple de sororité03.
— Votre métier dans 20 ans, ça ressemblerait à quoi ?
Un métier qui ne va absolument pas prendre une ride, car on est à un tournant historique entre deux époques politiques. Les sciences politiques doivent être à l’avant-garde dans la compréhension du temps réel pour aider nos contemporains. Ma discipline est centrale dans ce qui est en train de se jouer aujourd’hui. Mais si ça va trop loin, sera-t-on audibles à temps ?
— Avec quelle part d'IA ?
L’IA est un outil industriel qui sera partout, comme l’électricité à un moment donné, et l’on finira par s’y habituer. Il y a deux aspects : l’IA comme outil de productivité dans l’industrie (on y arrivera progressivement, étape par étape), et l’IA privée, au service d’agendas idéologiques, parfois extrêmes. C’est cet aspect-là qui me dérange tant qu’on ne connaît pas les intentions qui guideront l’IA. Un outil pour discriminer, virer, cibler, persécuter ? C’est une perspective potentielle, malheureusement.
— Comment inspirer les jeunes politologues d'aujourd'hui et susciter des vocations demain ?
J’ai une punchline pour ça : rejoindre le combat ! Les politologues, hommes et femmes seront au cœur du siècle, au cœur de la fabrique de l’Histoire, pas à côté, pas consommateurs ni témoins, mais acteurs. Intellectualiser, poser des idées et des systèmes, c’est se réapproprier le réel et le rendre intelligible aux autres. Exercer ce métier aujourd’hui, dans un monde qui bascule, c’est suivre les mots d’Antonio Gramsci : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». C’est à nous d’être très vigilants, et les sciences politiques, les politologues, sont à l’avant-garde de ça.
— S'il fallait créer un métier utile à l‘horizon 2050, quel serait-il ?
Deux métiers qui ne me font pas plaisir, mais je crains qu’ils soient inévitables avec les guerres cognitives qui nous attendent : agents de sécurité cognitive et spatiale. Le premier vérifierait la façon dont nos activités cérébrales seraient monitorées selon les règles du moment (encore faut-il savoir pour qui il travaille). Le second agirait lorsqu’Elon Musk, Neuralink et d’autres nous amèneront sur Mars.
01 – Entrepreneur milliardaire français, fondateur de Smartbox, souvent décrit comme conservateur, fervent catholique et proche de l‘extrême droite.
02 – Concept théorisé par le sociologue Zygmunt Bauman pour décrire notre société consumériste et notre quête incessante de mobilité et de vitesse. Les structures sociales, familiales ou professionnelles, jusqu‘alors considérées comme des socles, ne résistent pas à la peur des individus de rater le changement. La « société liquide » accorde une liberté totale, sinon perverse.
03 – Terme né dans les années 1970 pour définir la solidarité entre femmes.